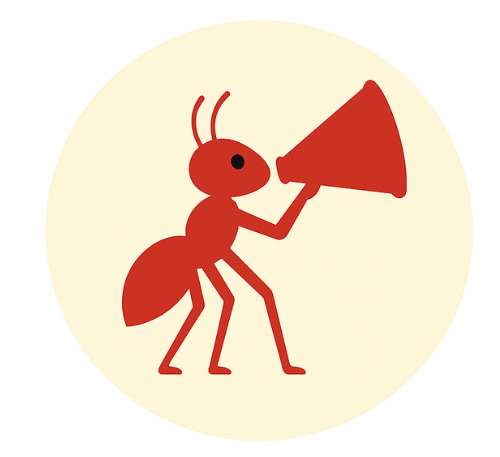En France, si le racisme s’installe si facilement dans les universités, c’est qu’il en garde les portes
En 2019, le gouvernement d’Édouard Philippe présentait le plan « Bienvenue en France », censé augmenter « l’attractivité pour les étudiants internationaux ». Mise en place d’une véritable politique de sélection par l’argent, cette stratégie vise à l’augmentation des droits d’inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Ces derniers doivent désormais débourser près de 2770 euros pour une licence et 3770 euros pour un master. « Bienvenue en France », disent-ils… ironique.
Si Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ont initié la politique de l’« immigration choisie » avec la loi CESADA (loi sur le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) en 2006, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, eux, ont parachevé cette œuvre. Entre exigence méritocratique, vision utilitariste de l’immigration et logique sécuritaire, la stratégie « Bienvenue en France » rompt avec une tradition républicaine, celle de l’égal accès à l’instruction pour toutes et tous. Le Conseil constitutionnel, saisi de la question, n’a pas daigné bouger le petit doigt (cf. Décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019).
Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. Comme le soulignent Antonin Durand et Guillaume Tronchet, les universités françaises, de tradition plutôt internationaliste sur la question, se sont construites comme un vecteur de rayonnement de la France à l’international. Imprégnés d’un républicanisme immodéré, le XVIIIᵉ et le XIXᵉ siècle sont marqués par une forte mobilité étudiante au sein de la classe intellectuelle. Les objectifs sont clairs : la diffusion des idées républicaines, l’attractivité de la Nation et la promesse d’un nouveau relais à l’international. Est alors entreprise une véritable politique d’intégration qui passe essentiellement par le logement. C’est ainsi qu’en 1925, la Cité universitaire de Paris voit le jour.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les universités françaises tendent à une aspiration pacifiste et internationaliste. Des accords sont alors signés avec les pays de la Petite Entente et le programme Erasmus voit le jour en 1987 dans le cadre de l’intégration européenne.
Mais voilà que tout bascule. Dans le courant des années 1950 et 1960, les étudiants en provenance des colonies françaises d’Afrique, d’Asie et des nouveaux États indépendants du Maghreb veulent également étudier. Est alors mise en place une véritable politique de sélection basée sur le mérite par l’octroi dans le courant des années 1970’s de bourses du gouvernement français afin de sélectionner les « meilleurs », les « talents ». Cela crée alors une inégalité de traitement selon la provenance des étudiants. Si les accords d’échanges réciproques avec des universités prestigieuses, notamment nord-américaines, fleurissent, on ne peut pas en dire autant des continents moins développés.
Dès 1979 et l’adoption du décret « Imbert », les conditions d’accueil se rigidifient, le gouvernement français mettant en place une série de conditions : engagement à repartir à la fin des études, test de langue, conditions de ressources…
Loin de déranger les socialistes, cette politique sera continué et accéléré par la création de l’agence EduFrance en 1999 lors de la cohabitation. Les ministres de l’éducation, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre, et des affaires étrangères, Hubert Védrine assument cette conception mercantile des migrations étudiantes. Mise en place de prestations payantes aux étudiants étrangers (inscription, visa, autorisation de travail…), l’agence EduFrance s’inspire, sans se le cacher, des stratégies anglo-saxonnes et notamment de l’Education Counselling.
En 2011, l’Agence nationale Campus France prend la relève d’EduFrance. Elle est chargée de « la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, de la gestion des bourses des gouvernements français et étrangers et de l’accueil des étudiants internationaux ». Elle est, en fait, à l’origine des nombreux mécanismes et filtres de sélection de l’arrivée des étudiants étrangers en amont de ceux des universités. Tout étranger souhaitant étudier en France – excepté ceux déjà dans le système scolaire français à l’étranger – doit passer par cette plateforme.
Après avoir fourni un acte de naissance, un certificat de nationalité, une carte d’identité et un passeport – pièces qui nécessitent un paiement d’une dizaine d’euros – une connexion internet régulière, des photos d’identité conformes et la duplication de pièces administratives, les futurs étudiants doivent souscrire à une assurance voyage rapatriement, fournir les justificatifs d’une réservation d’un vol aller-retour et attester d’un hébergement pendant la durée du séjour. Les agents consulaires demandent également une situation économique stable, soit un apport mensuel de 615 euros ou le soutien d’un proche qui dispose d’un compte bancaire dans lequel est planifié l’envoi de 615 euros tous les mois, soit 7380 euros. Un investissement difficile lorsque, par exemple, le salaire médian en Afrique est de 120 euros par mois.
Reste alors l’autre voie possible pour intégrer une université française : l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Ce réseau d’établissements scolaires homologués par l’Éducation nationale et sous tutelle du ministère des Affaires étrangères accueille près de 390 000 élèves, dont 70 % d’étrangers. Ce sont les « écoles françaises à l’international ». Permettant aux lycéens de passer par Parcoursup, elle est un véritable vecteur de mobilité des étudiants internationaux. Mais là encore, les futurs étudiants n’échappent pas à la règle. En plus d’un investissement matériel de plus de 5 000 euros en moyenne par an, l’investissement à faire est tout autre (social, scolaire, linguistique et symbolique).
À en croire les procédures de sélection, les « talents » sont en fait les plus riches.
Mais une fois en France, les étudiants étrangers, s’ils sont certes étudiants, demeurent avant tout étrangers.
Sous l’épée de Damoclès que constitue le titre de séjour, 80 % des étudiants étrangers estiment que les démarches administratives constituent leur plus grand défi une fois arrivés en France. Entre temps d’attente interminable à la préfecture et retard dans la délivrance du titre, les répercussions sur la santé mentale sont bien réelles. Il faut ajouter que les critères de sélection varient d’une préfecture à une autre, ce qui rajoute son lot de confusion.
À l’image de Rayen Fakhfakh, étudiant en médecine et tunisien arrivé en France à l’âge de 12 ans, les étudiants étrangers peuvent se voir attribuer une OQTF (obligation de quitter le territoire français) par la préfecture au motif de « ne pas justifier d’insertion professionnelle ni de perspective d’emploi ». Décision relevant du préfet, la France en a distribué 15 000 en 2024, soit 39 % de plus qu’en 2023, ce qui n’a pas empêché Gérald Darmanin, ancien ministre de l’Intérieur, de s’en féliciter.
Rappelons-le, « Bienvenue en France ».
C’est dans ce contexte raciste qu’en 2019 est venu s’ajouter aux contraintes déjà posées les droits d’inscription différenciés aux universités pour les étudiants étrangers dès la rentrée 2019-2020.
Si les universités sont libres d’octroyer les droits différenciés ou pas, on observe une augmentation de l’utilisation de ce mécanisme dans un contexte de baisse générale du budget de l’enseignement supérieur.
La stratégie « Bienvenue en France » se fonde sur une discrimination sociale et géographique. Lorsque Édouard Philippe déclare que les « étudiants indiens, russes, chinois seront plus nombreux et devront l’être », il oublie de préciser que c’est parce qu’ils viennent de pays aisés. Il faut comprendre par là que les étudiants ne pouvant pas payer se verront proposer plutôt des antennes d’universités françaises dans leur pays d’origine. Maigre consolation…